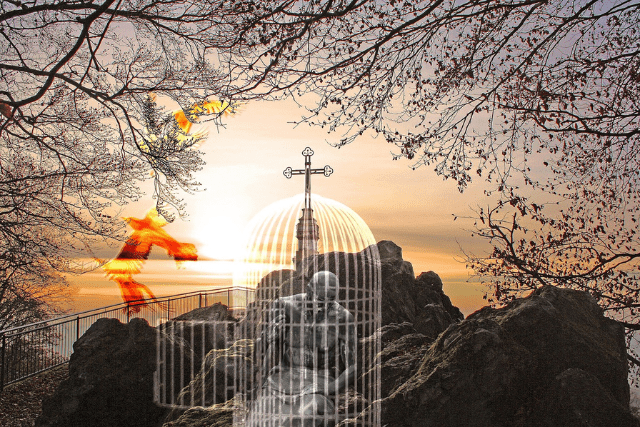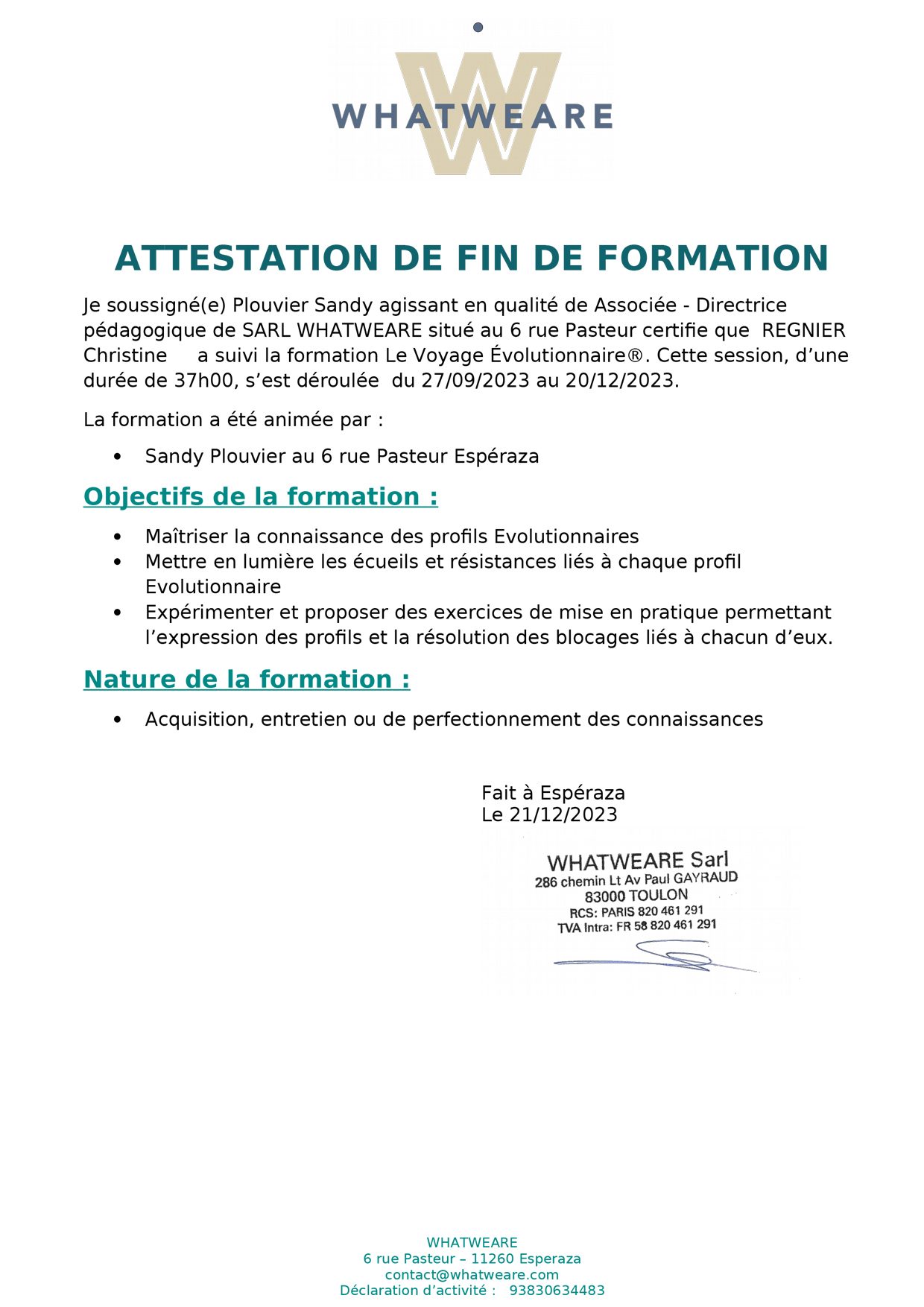Texte rédigé en 2013, confié à Holistik Magazine/Sofia Barao.
Pashupatinath[1] semble aussi désert qu’il est obscur. Silence. Seule la faible lueur dansante d’un bûcher au-delà du temple donne vie à ce lieu dédié à la mort.
Ensemble, nous franchissons le passage qui descend en pente douce vers les ghats[2], silencieux nous aussi. La paix règne entre nous, et je nous sens reliés par cette marche vers Bishwa et son père.
Un premier groupe est réuni près du bûcher d’où émanait l’unique lumière.
Nous marchons le long des ghats, en quête attentive de Bishwa et de ses proches.
De l’autre côté du pont, seul le visage connu de Bishwa nous indique le groupe que nous cherchons ; à leurs pieds, le linceul orange dont la couleur vive semble vouloir nier la mort elle-même enveloppe le corps du père, allongé sur l’espace incliné au milieu des escaliers, les pieds presque à fleur d’eau. Bishwa est là, pieds nus sur la pierre teintée des pigments rituels rouges, le jean roulé sous les genoux. L’expression de son visage m’évoque celle d’un petit garçon. Autour de lui, une quinzaine de personnes debout sur les marches, semble attendre, apparemment désœuvrées.
Une certaine émotion me gagne, un sentiment de solennité, que je suis sans doute la seule à ressentir. Des hommes présents, tous népalais, se dégage une telle impression de « normalité » que je me sens isolée dans ma perception de la mort. Pour eux, l’instant n’a rien d’extraordinaire, visiblement. Ils sont justes « là », si habitués à partager ce temps de la crémation.
Bishwa nous a vus. Échange de regards chargés de nos liens, emplis de tacite proximité, d’assurance de notre présence, d’amitié, de partage de ce qui se joue. Parler est superflu. Nous sommes tous là près de lui. Il prend l’essentiel que représente notre présence sur ce ghat dans la nuit, silencieux à quelque distance du groupe. Cela lui suffit, je le sais. Je sais aussi que nous voir lui fait du bien, même s’il ne semble pas en avoir besoin. Cependant, son père est mort il y a trois ou quatre heures ! Sa tranquillité nous touche et force notre respect. Le franchissement du passage du chevet du malade à ce ghat de crémation me semble trop rapide, mais le visage de Bishwa ne montre ni surprise ni résistance. Il suit le cours d’une séparation pour nous si souvent douloureuse avec une simplicité qui me remue, mais dont la paix me gagne.
Retentit alors le son rauque d’une conque, et je vois un jeune homme qui souffle dans un gros coquillage blanc, celui-là même avec lequel on chasse les démons dans les rues la nuit avant un certain festival. Plusieurs fois la conque lance son étrange cri dans la nuit.
Quelques gestes soulèvent le linceul, glissent quelque chose sur le corps nu et j’aperçois les pansements sur l’abdomen, qui curieusement, rendent la mort plus réelle encore, en révélant les stigmates sur le corps sans vie des souffrances des semaines passées. C’est comme si cette gaze blanche m’apparaissait comme responsable de notre présence près du bûcher… avec un sentiment d’aboutissement et de soulagement pour le malade cet après-midi encore torturé et désormais libéré.
La mort a à cet instant pour moi un visage concret cru, une trivialité et une beauté à la fois qui m’emplissent de Réel, accompagnées d’un sentiment puissant d’inéluctable qui me concerne intensément. Je suis comme cet homme couché sur ce ghat ; rien ne me sépare ni ne me différencie de lui, par nature.
J’aperçois une femme, la seule hormis moi. Elle pleure. J’ignore qui elle est, mais je la vois si seule dans son chagrin qu’un mouvement me porte vers elle, que je retiens. Elle se retire dans une petite construction du temple réservé aux familles des disparus. Elle s’assied et pleure, dos aux ghats, comme pour s’extraire de la scène et la nier, se préserver de l’insupportable pour elle. Je voudrais tellement aller lui prendre la main, accroupie à ses genoux, sans rien dire, juste pour être avec elle et soulager ses pleurs. Mais je n’ose pas. Elle ne me connaît pas et la pudeur m’interdit de m’immiscer dans son espace de tristesse. On me dit qu’elle n’est pas l’épouse, celle-ci n’ayant pas supporté d’être présente, est restée à la maison avec sa fille, toutes deux comme isolées dans leur chagrin[3].
Un mouvement parcourt le groupe, et des hommes s’approchent avec une sorte d’échelle en bambou.
Plusieurs personnes s’activent autour du linceul orange vif, et je comprends le rôle de cet objet mystérieux jusque là. Bishwa et d’autres hommes se saisissent du corps que la rigidité cadavérique n’a pas encore eu le temps de gagner, et le déposent sur le brancard, ajustent les mains du père réunies sur l’abdomen torturé. Ils sont six ou peut-être huit à conjuguer leurs efforts pour le soulever, dont Bishwa, et le cortège se met en marche vers le bûcher. De nouveau une émotion me gagne par cet ultime geste des enfants qui portent celui qui les a portés.
Nous suivons en modeste cortège le long des ghats.
Les porteurs gravissent avec quelques difficultés les quelques marches étroites qui mènent à la plateforme de pierre, elle aussi exiguë, où trônent les grosses bûches funèbres prêtes à accueillir le père et son flamboyant linceul dans leur berceau. Selon le rituel, les porteurs font trois fois le tour du bûcher, tenus de veiller à ne pas faire de faux-pas sur cet espace si étroit, exercice qui semble malaisé. Puis ils déposent le brancard à côté du berceau de bûches, et, après encore quelques gestes rituels de préparation orchestrés par le prêtre de la mort, prennent le corps et le disposent délicatement sur le lit de bois.
Le prêtre dégage le visage du père. La mort et son inéluctabilité se saisissent à nouveau de mes sens. Ici, pas de maquillage, pas de bel habit, pas de satin ni de fleurs, rien pour masquer ou atténuer le Réel. La mort se tient à deux pas de vous, semblant vous dire « un jour, ce sera toi sur ces bûches ». Et l’acceptation naît de l’évidence de la scène. Ce qui se déroule sous mes yeux est si vrai, si authentique, que résister ne serait que vain et futile.
Je suis emplie de gravité, de solennité, mais aussi de simplicité, de ce sentiment de proximité, d’un sentiment de fraternité profonde. « Non, je ne suis en rien différente de toi qui reposes sur ce dernier lit qui n’est plus lit de souffrance… ».
Je ne peux empêcher l’étonnement de me gagner devant l’attitude détachée de l’assemblée de ces hommes, cette sensation si forte que pour eux l’instant est normal, banal, ordinaire, qu’il n’éveille pas d’émotion ni de pensée particulière. Je me sens isolée moi aussi dans l’expérience intense que je vis, dans la densité de sensations, de perceptions, de pensées qui se concentrent en moi, mais gagnée par la tranquillité de ceux qui m’entourent.
Un singe s’approche de la plateforme toute proche, suivi bientôt par d’autres… Nous sommes distraits un instant par ces visiteurs indifférents et insolents, qui viennent se régaler des petits tas de riz restant peut-être d’une précédente cérémonie, ou que quelqu’un a placés là à leur intention. L’un de mes employés attire mon attention sur un des singes : il n’a que des moignons aux pattes avant, et bien que privé de mains, il mange le riz accoudé à même le sol, ne semblant pas gêné par son handicap. Un moment mes pensées vagabondent en tentant d’imaginer sa vie de singe sans mains…
Je suis ramenée à la réalité quand le prêtre place un collier de fleurs de la couleur du linceul autour du cou du défunt.
Il y a un échange de paroles entre les proches et lui. Les trois garçons déposent des pigments rouge vif sur diverses parties du corps. Suivent quelques gestes rituels qui échappent au film de la cérémonie. Le prêtre fait des gestes cachés à ma vue par l’écran de sa silhouette, et je réalise lorsqu’il s’écarte qu’il a placé dans la bouche même du père une sorte de gros tampon qui me semble être de cire blanche, qui couvre le bas du visage. Ce détail me percute par sa trivialité, comme une profanation à mes yeux, bien que rituel sacré – dont le sens m’échappe.
Il tend ensuite aux trois fils une petite planchette de bois sur laquelle brûle un fétu de paille. Les trois garçons sont très proches les uns des autres. Alors que chacun des autres touche le précédent en un geste émouvant de lien sacré inaltérable et de rapprochement dans la perte, le frère aîné de Bishwa porte la flamme sur le tampon de cire qui s’enflamme. Puis ils descendent tous trois les quelques marches qui mènent à la rivière, recueillent de l’eau dans leurs mains en coupe et la versent sur les flammes qui ne semblent pas y être sensibles. Ils s’écartent alors définitivement du bûcher pour laisser le feu accomplir son rôle purificateur de dispersion du père…
La cire brûle sur la bouche du mort, une flammèche tombe sur l’épaule, une autre sur l’œil gauche où elle reste, grillant le sourcil broussailleux. Je vois la chair du visage léchée par les flammes indifférentes et je l’imagine avec une certaine inquiétude se craqueler et griller sous la chaleur, je devine les poils obligés de s’abandonner au feu inévitable, la fumée s’élève doucement. Les flammes me semblent cruelles de s’attaquer sans concession au corps d’un être humain. Je suis soudain absorbée toute entière par la traînée de cire qui semble couler comme une larme de l’œil droit le long de la tempe, comme d’un pleureur couché, symbole à mes yeux de la libération de la tristesse, de la souffrance, du chagrin d’une vie douloureusement achevée à peine quelques heures auparavant. Cette larme de cire qui ne cesse de couler me touche et s’imprime en moi plus que tout le reste de la scène… C’est comme si cet homme s’exprimait en défiant le silence et l’imminence de la fin.
Le prêtre couvre le corps de paille qui s’enflamme doucement. Il place des fagots de petit bois dans l’espace ménagé sous l’édifice de grosses bûches.
Monte alors l’épaisse fumée de la crémation, en puissants volutes blanchâtres qui font contraste sur la noirceur et l’immobilité du ciel. On n’entend que le craquement du feu.
En suivant longtemps du regard levé vers le haut ces tourbillons légers, je réalise avec acuité que cet homme est en train de retourner à l’Univers, que ses molécules franchissent elles-aussi le passage de la transformation, que de chair elles deviennent air et gaz, qu’en s’élevant vers les nues, elles reprennent leur véritable nature, que le corps n’en est qu’une forme apparente, ponctuelle et fragile. Le père expansé se fond désormais dans le grand tout, sans plus de séparation inhérente à la nature humaine, il retrouve l’unité, l’immensité, la paix et l’équilibre de la Nature. Comme la larme de cire un instant auparavant, ces bouffées d’Être humain qui se dissolvent et s’envolent laissent une empreinte profonde en moi, en un implacable mais doux voile.
Le corps brûle, Bishwa s’approche de nous. Les quelques mots échangés n’évoquent pas la proximité en cet instant. La pudeur masque ce que les regards se disent. La simplicité des uns et des autres face à la mort d’un père me semble plus touchante que la mort elle-même. Pour ces jeunes hommes que je côtoie au quotidien, ces instants n’ont rien d’exceptionnel qui mérite qu’on s’y arrête ou qu’on en parle. Ils ont vécu ce moment comme un autre, mais sont restés auprès de leur chef et collègue jusqu’à la fin, très tard dans la nuit, ne faisant aucun cas de la fatigue ni de leur intérêt personnel. L’évidence les appelait à être là, sans une hésitation, en une tacite priorité. Et j’ai été réellement heureuse d’être là avec eux, si proche et pourtant si différente dans ma perception d’un acte aussi sacré.
[1] Pashupatinath est le plus haut lieu sacré pour les crémations au Népal. Être incinéré là signifie pour les Hindous être lavé de tous ses péchés.
[2] Ghat : sortes de quais en bord de rivière, constitués de marches qui descendent jusqu’à l’eau, et ponctués de plateformes dédiées aux crémations.
[3] Selon le récit détaillé que mon ami Rishi m’avait fait des funérailles en 2003, les femmes sont absentes des crémations, et à ma question du « pourquoi », Rishi m’avait répondu : « parce qu’elles pleurent trop ».